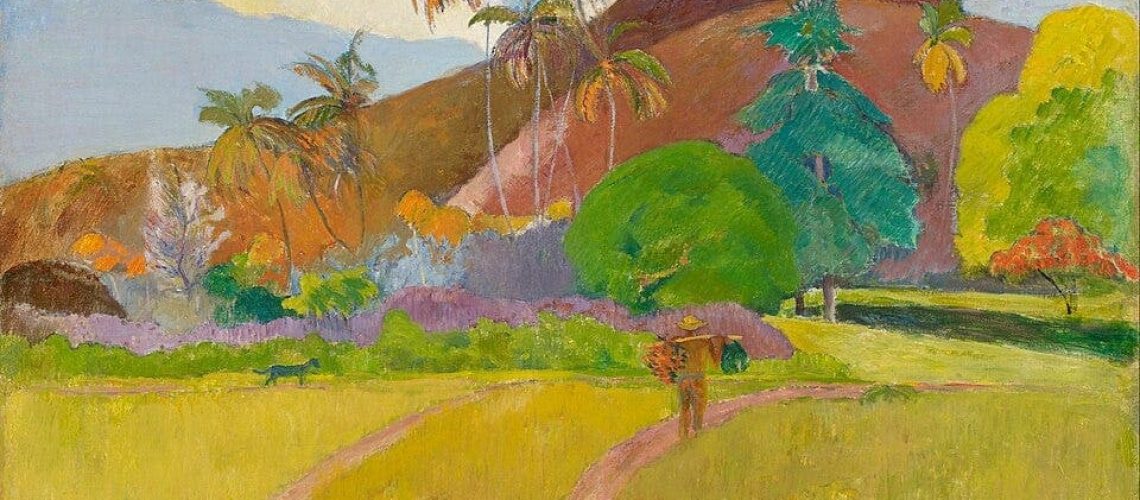La tâche principale d’un rabbin est de trouver l’équilibre entre l’ancien et le nouveau. Depuis mon arrivée ici à Paris il y a quatre ans (!) — et plus encore depuis que j’ai pris mes fonctions de rabbin principal d’Adath Shalom l’année dernière — j’ai essayé de consacrer environ quatre-vingts pour cent de mon temps et de mon énergie à maintenir le rythme de cette communauté précieuse, et vingt pour cent à expérimenter de nouveaux projets. Certains aboutissent, d’autres moins.
La dernière initiative que j’ai annoncée il y a quelques semaines est aussi une expérience qui relie l’ancien et le nouveau. Je me suis fixé comme défi pour cette année, de Roch Hachana 5786 jusqu’au prochain Roch Hachana 5787, d’amener au moins cinquante personnes à accomplir quelque chose pour la première fois. Et aussi que des membres de la communauté, qui savent déjà faire certaines choses, transmettent leur savoir à ceux qui ne savent pas encore.
L’idée, c’est d’encourager chacun à franchir doucement la barrière de la timidité, pour réaliser ce qu’il a peut-être toujours rêvé de faire. C’est un peu une caricature, mais j’ai appris que les Français sont souvent perfectionnistes, et préfèrent parfois ne rien faire du tout plutôt que de mal faire. Ce n’est pas grave, mais j’espère que cette initiative donnera davantage de confiance et de compétences à notre communauté. Et qu’après ces cinquante personnes, cinquante autres, puis encore cinquante, continueront à apprendre et à grandir dans leurs compétences juives. [Inscrivez-vous ici !!]
J’ai appelé cette initiative « le Projet Chehe’hiyanou », en référence à la bénédiction que l’on récite lorsqu’on accomplit une mitsva pour la première fois. C’est une bénédiction curieuse : on la dit aussi bien lorsqu’on reçoit une bonne nouvelle, lorsqu’on retrouve de vieux amis, lorsqu’on accomplit une mitsva qui ne revient qu’une fois par an ou moins, ou encore lorsqu’on met un vêtement neuf ou qu’on goûte à un fruit nouveau.
La coutume s’est développée à Roch Hachana de faire exprès de manger un fruit nouveau afin de pouvoir dire cette bénédiction. Il y a une raison technique à cela, liée au doute concernant les deux jours de Roch Hachana, mais il se peut aussi qu’il y ait un sens plus profond à cette pratique.
Voici la bénédiction :
בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה
« Béni sois-Tu, Dieu, souverain de l’univers, qui nous a maintenus en vie, nous a permis d’exister et nous a amenés jusqu’à ce jour. »
Chehe’hiyanou — « Tu nous as fait vivre », ou « Tu nous as donné la vie ». Peut-être que le sens simple de ces mots, c’est que nous sommes heureux d’être arrivés jusqu’à ce moment précis, où nous pouvons vivre cette expérience : que ce soit goûter un fruit nouveau, lire la Torah pour la première fois, ou entendre le Chofar pour la première fois de l’année. Nous savons combien la vie est fragile ; cette bénédiction nous rappelle que le simple fait d’être là, ici et maintenant, ne va jamais de soi.
Mais il y a aussi une autre manière de comprendre cette expression Chehe’hiyanou : c’est que cette expérience nouvelle, en elle-même, nous donne la vie. Nous sommes plus vivants, notre existence est plus riche et plus complète, après avoir accompli cette chose nouvelle. La « vie », ici, n’est pas une réalité binaire, mais un spectre : et par certaines actions, nous devenons, tout simplement, plus vivants.
Dans nos prières de Roch Hachana, nous insistons sur la vie, encore et encore. Nous ajoutons cette phrase dans la Amida :
זָכְרֵנוּ לְחַיִּים. מֶלֶךְ חָפֵץ בַּחַיִּים. וְכָתְבֵנוּ בְּסֵפֶר הַחַיִּים. לְמַעַנְךָ אֱלהִים חַיִּים
« Souviens-Toi de nous pour la vie, ô Roi, qui désires la vie. Inscris-nous dans le Livre de la Vie, pour Toi, Dieu de vie. »
Que signifie cette prière ? Là encore, on peut l’entendre de manière binaire : nous ne voulons tout simplement pas mourir maintenant. Traditionnellement, Roch Hachana est imaginé comme le jour du jugement divin, où le nombre de nos jours à venir est décidé. Et bien sûr, nous prions pour vivre encore une année. Ce n’est jamais quelque chose d’acquis ; et sentir notre proximité avec la possibilité de la mort peut nous pousser à réfléchir à nos actions, à nos choix.
Mais il y a une deuxième manière de comprendre la vie : nous ne voulons pas seulement « ne pas mourir», nous voulons véritablement vivre, et mener une vie qui en vaille la peine. Nous voyons Roch Hachana comme l’anniversaire de la création du monde, ou de la création de l’humanité. Le récit de la Genèse n’est pas une description scientifique de la formation de l’univers, et n’a jamais eu cette intention. La Torah est là pour nous transmettre un enseignement à travers ce récit. Mais quel enseignement ?
Le penseur juif, le rabbin Yitz Greenberg, dans son livre The Triumph of Life, analyse ce qu’il appelle les trois rythmes fondamentaux de la création, qui nous montrent la direction dans laquelle notre monde est censé aller.
Le premier rythme est celui qui va du chaos à l’ordre, du tohou va-vohou au Chabbat. Naturellement, le monde tend vers le désordre, c’est le principe de l’entropie, mais avec assez d’énergie, cette tendance peut être inversée.
Le deuxième rythme est celui qui va de la non-vie à la vie. Il n’y a pas de vie aux jours un et deux ; la végétation apparaît au troisième jour ; et à la fin de la semaine, la terre foisonne d’animaux, de poissons, d’oiseaux et enfin d’êtres humains. Le désir de Dieu pour la vie résonne à travers tout le récit de la création.
Et le troisième rythme fondamental est celui de l’élévation de la qualité de vie. L’évolution de la vie, des organismes unicellulaires aux formes de vie plus complexes, avec plus de conscience, la capacité de parler et de prendre conscience de soi. L’humanité est décrite comme créée à l’image de Dieu : cela ne veut pas dire que Dieu a deux mains et deux jambes, mais plutôt que nous avons le potentiel de poursuivre ce processus de création, en suivant ces mêmes rythmes fondamentaux. Ce message revient sans cesse dans la Torah : soyez saints, choisissez la vie.
La Torah nous demande beaucoup. Parfois, nous trouvons tous les détails inscrits dans un code de règles : nous savons précisément comment fabriquer un Chofar, comment en jouer et dans quel ordre ; nous savons quelles paroles dire à Yom Kippour et que nous ne devons pas manger pendant vingt-cinq heures. Mais les exigences les plus complexes ne figurent pas dans les livres de halakha. Quels choix devons-nous faire dans nos relations, dans nos carrières, dans nos familles, dans nos sociétés ?
La Torah nous demande de choisir la vie, de la faire grandir, et de l’approfondir. C’est peut-être ce critère-là qu’il faut appliquer pour prendre des décisions difficiles et évaluer nos actions: est-ce que nous faisons progresser la vie ou non ? Avons-nous rendu le monde plus vivant ou non ? Notre vie est-elle plus profonde et plus riche en conséquence de ce que nous avons fait ou non ? Si oui, nous faisons écho et nous poursuivons l’histoire de la création.
C’est facile à dire, et bien sûr beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Très souvent, nos dilemmes se jouent entre vie et vie. Passer du temps à lire un roman ou avec son conjoint, c’est un choix entre approfondir la vie et approfondir la vie. Choisir entre un travail intellectuellement et spirituellement épanouissant et un travail qui rapporte assez d’argent pour vivre confortablement peut aussi se comprendre comme un choix entre vie et vie. Si vous souhaitez donner la tsédaka selon ce critère de promotion et d’approfondissement de la vie, les possibilités sont infinies. Et pourtant, réfléchir à travers ce prisme n’est pas vain : cela affine les questions et éclaire les véritables enjeux.
« Souviens-Toi de nous pour la vie, ô Roi, qui désires la vie. Inscris-nous dans le Livre de la Vie, pour Toi, Dieu de vie. »
Si nous devons choisir la vie, nous sommes aussi appelés à rejeter les actions contraires à la vie, partout où elles se trouvent. Il y a presque deux ans, encore sous le choc des attaques brutales commises par le Hamas, notre soutien instinctif à une opération militaire pour défendre Israël et ramener les otages venait de cette soif profonde et authentiquement juive de vie. Presque aussitôt, la phrase qui a résonné dans toute la communauté juive de France a été : Am Israël ‘Haï — cela veut dire, comme l’a dit Joann Sfar, « nous vivrons ». Cela signifie aussi : nous voulons que tout le monde vive, même si cela implique temporairement la guerre. Nous avons défilé dans les rues, nous avons affiché encore et encore des images, pour exiger du monde entier que la vie des otages ne soit pas oubliée.
C’est exactement dans le même esprit juif que nous pouvons — et devons — rejeter authentiquement les paroles contraires à la vie, même lorsqu’elles sortent de la bouche de personnes portant une kippa. Ceux qui appellent à la famine, qui célèbrent les massacres aveugles, qui transforment la guerre la plus légitime d’Israël en actes de vengeance et de conquête — on peut être juif et sioniste, et rejeter cela.
Nous avons aujourd’hui une place à la fois difficile et importante dans le monde juif : défendre Israël contre ceux qui nient son droit d’exister, et défendre aussi le sionisme contre ceux qui l’empoisonnent de l’intérieur, en manipulant notre soutien aux otages et à Am Israël pour commettre, en notre nom, des actes de cruauté et de violence.
Cette année, nous devons continuer à élever la voix sur ces deux fronts : soutenir le peuple d’Israël, et rejeter explicitement les politiques concrètes qui nient la sainteté de la vie. Am Israël ‘Haï : cela veut dire que nous vivrons — mais aussi que nous voulons continuer à chercher une vie digne d’être vécue, une vie dont nous soyons fiers, et un judaïsme dont nous soyons fiers.
Les thèmes de la prière d’aujourd’hui sont malkhouyot, zikhronot et shofarot — la souveraineté, le souvenir et le son du chofar. Les deux derniers sont intimement liés : nous utilisons le chofar pour rappeler à Dieu de se souvenir de nous, pour nous rappeler à nous-mêmes de nous souvenir de Dieu, et aussi pour nous rappeler de nous souvenir de nous-mêmes. C’est un appel au réveil : revenir à ce que nous sommes, retrouver notre essence, réévaluer nos actes et nos choix, et progresser vers la version la plus authentique de nous-mêmes. Si nous demandons à être inscrits pour la vie dans le Livre de la Vie, il nous faut sans doute nous souvenir de ce mot-là aussi : en évaluant nos décisions, nous demander — est-ce que cet acte affirme, promeut et approfondit la vie, ou bien l’inverse ?
Si vous cherchez des réponses faciles à ces questions, vous n’êtes pas dans la bonne religion ! Mais si vous cherchez de bonnes questions avec lesquelles lutter tout au long de cette nouvelle année, c’est aujourd’hui qu’elles peuvent être posées.
Que l’année qui vient soit douce et pleine de sens — Lechana tova oumetouka, tekatevou vete’hatémou !