Erev Roch Hachana 5786
Chana tova. Jusqu’à présent, cette année 5786 a débuté sans encombre, et j’espère qu’elle se poursuivra ainsi tout au long des douze mois à venir. Et si jamais elle devient moins paisible, si nous rencontrons des surprises et des épreuves, puissions-nous recevoir la force de nous y mesurer et de faire ce qui est juste.
La soirée de Roch Hachana possède sa propre magie, ses propres évocations, en particulier autour des aliments que l’on consomme ce soir. Mais j’aimerais déjà évoquer le grand moment de demain : le chofar qui sera sonné le matin. Et je commencerai par une histoire concernant Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi, fondateur du mouvement que l’on appelle aujourd’hui ‘Habad-Loubavitch, connu sous le nom de l’Alter Rebbe.
Lors de la guerre de 1812 entre la France et l’Empire russe, les communautés juives étaient prises en étau. Certaines espéraient la victoire de Napoléon, séduites par les idéaux révolutionnaires, dans l’espoir d’obtenir l’émancipation. L’Alter Rebbe, lui, exprima clairement son opposition à Napoléon : il était persuadé que si les Juifs obtenaient la liberté, ils s’assimileraient et disparaîtraient, tandis que sous l’oppression, ils resteraient isolés et fidèles à leur tradition. Lui et ses disciples réussirent même à traverser les champs de bataille et à transmettre aux Russes des informations militaires essentielles sur les forces françaises.
Mais la véritable bataille ne se menait pas par les soldats, bien sûr, mais par les prières des juifs. L’Alter Rebbe priait pour que Napoléon perde, tandis que le Maguid de Kozhnitz [mais dans certaines versions : Rabbi Chlomo de Karlin] priait pour qu’il gagne. À l’approche de Roch Hachana 5573, dans le petit village de Teriza Zerka, une croyance se répandit parmi les juifs : celui qui ferait retentir le premier le son du chofar serait exaucé dans sa prière. Le grand jour arriva, et le Maguid de Kozhnitz se leva de très bonne heure. Il se hâta d’aller au mikvé, puis rassembla aussitôt un minyan. Ils récitèrent rapidement la prière du matin, sautant toutes les méditations et les chants habituels. Le Maguid porta le chofar à ses lèvres, prêt à souffler. Mais avant même d’émettre un son, il baissa soudain le chofar, poussa un soupir, et déclara : « L’Alter Rebbe a été plus rapide, il a gagné. »
Et ainsi en fut-il : l’armée française fut anéantie, marquant le début de la fin pour Napoléon lui-même. Lorsque le Maguid rencontra de nouveau l’Alter Rebbe, il lui demanda comment il avait pu arriver si vite à la sonnerie du chofar. Le Rebbe répondit qu’il s’était simplement levé le matin, avait soufflé le chofar, puis avait ensuite poursuivi l’office normalement. Il considérait que l’enjeu était si important que l’ordre habituel des prières ne s’imposait plus.
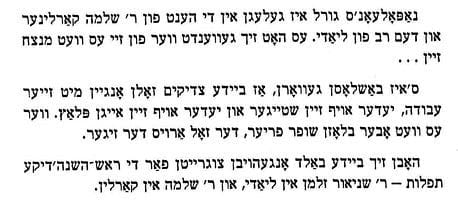
Lorsque j’ai découvert cette histoire pour la première fois, j’ai été frappé par tout ce qui a changé, et par la manière dont le mouvement ‘Habad-Loubavitch a fini par embrasser la France et sa culture. Mais en réalité, ce point est secondaire, bien moins intéressant que les questions théologiques et philosophiques soulevées par l’histoire elle-même. Car au cœur de ce récit se trouve une conviction profonde : nos rites peuvent transformer le monde.
Cette conviction a une dimension qui frôle le narcissisme, voire l’hérésie. Si ce qu’un rabbin fait — ou ne fait pas — détermine le sort des armées et des empires, alors nous sommes face à une vision très infantile de Dieu, un Dieu qui prendrait ses décisions en fonction du rabbin qui souffle le premier dans son chofar magique. Mais avant de rejeter cette manière de penser comme étant idiote, naïve ou primitive, peut-être faut-il y voir une occasion de réfléchir à ce que nous faisons vraiment lorsque nous sonnons du chofar. Est-ce que cela produit quelque chose ? Et si ce n’est pas le cas, pourquoi le faisons-nous ?
De nombreuses explications ont été données pour le chofar : les plus connues étant sans doute les dix significations présentées par Rav Saadia Gaon au IXe siècle. Maïmonide, le grand rationaliste, commence par affirmer que les rites ordonnés par la Torah n’ont pas de raison en soi. Mais immédiatement après cette affirmation, il propose malgré tout une explication.
אַף עַל פִּי שֶׁתְּקִיעַת שׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה גְּזֵרַת הַכָּתוּב רֶמֶז יֵשׁ בּוֹ כְּלוֹמַר עוּרוּ יְשֵׁנִים מִשְּׁנַתְכֶם וְנִרְדָּמִים הָקִיצוּ מִתַּרְדֵּמַתְכֶם וְחַפְּשׂוּ בְּמַעֲשֵׂיכֶם וְחִזְרוּ בִּתְשׁוּבָה וְזִכְרוּ בּוֹרַאֲכֶם
Bien que la sonnerie du chofar à Roch Hachana soit un décret de la Torah, elle contient aussi une allusion. C’est comme si l’appel du chofar disait : « Réveillez-vous, vous qui dormez, sortez de votre sommeil ! Vous qui somnolez, levez-vous ! Examinez vos actes, repentez-vous, souvenez-vous de votre Créateur ! … Améliorez vos voies et vos actions, et que chacun abandonne son mauvais chemin et ses pensées mauvaises… » (Michné Torah, Hilkhot Téchouva 3:4).
La sonnerie du chofar, en elle-même, ne produit rien. Ce n’est pas de la magie, mais bien un dispositif psychologique. De la même manière qu’on règle une alarme sur son téléphone pour ne pas oublier quelque chose, les Juifs soufflent dans le chofar une fois par an pour se rappeler ce qu’ils auraient toujours dû faire : devenir meilleurs, agir mieux. En un sens, c’est l’exact contraire de la « compétition » de chofar de l’Alter Rebbe, où il fallait souffler vite et seul, pour Dieu et non pour le peuple. Cela explique d’ailleurs pourquoi la bénédiction récitée est Lishmo’a Kol Chofar : « Béni sois-Tu … qui nous a ordonné d’entendre la voix du chofar. » La mitsva n’est pas de souffler, mais bien d’écouter — et plus précisément d’intérioriser le message, de se réveiller et de prendre de grandes décisions.
Mais, dans ce même passage précis, Maïmonide poursuit avec un autre exercice de pensée :
לְפִיכָךְ צָרִיךְ כָּל אָדָם שֶׁיִּרְאֶה עַצְמוֹ כָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ כְּאִלּוּ חֶצְיוֹ זַכַּאי וְחֶצְיוֹ חַיָּב. וְכֵן כָּל הָעוֹלָם חֶצְיוֹ זַכַּאי וְחֶצְיוֹ חַיָּב. חָטָא חֵטְא אֶחָד הֲרֵי הִכְרִיעַ אֶת עַצְמוֹ וְאֶת כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ לְכַף חוֹבָה וְגָרַם לוֹ הַשְׁחָתָה. עָשָׂה מִצְוָה אַחַת הֲרֵי הִכְרִיעַ אֶת עַצְמוֹ וְאֶת כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ לְכַף זְכוּת וְגָרַם לוֹ וְלָהֶם תְּשׁוּעָה וְהַצָּלָה… וּמִפְּנֵי עִנְיָן זֶה נָהֲגוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל לְהַרְבּוֹת בִּצְדָקָה וּבְמַעֲשִׂים טוֹבִים וְלַעֲסֹק בְּמִצְוֹת מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְעַד יוֹם הַכִּפּוּרִים יֶתֶר מִכָּל הַשָּׁנָה
Ainsi, tout au long de l’année, chacun doit toujours se considérer comme étant en équilibre parfait entre les mérites et les fautes, et voir le monde entier comme étant lui aussi en équilibre entre les mérites et les fautes. S’il accomplit une seule transgression, il fait pencher la balance pour lui-même et pour le monde entier du côté de la culpabilité et provoque la destruction pour lui et pour les autres. À l’inverse, s’il accomplit une seule mitsva, il fait pencher la balance pour lui-même et pour le monde entier du côté du mérite et apporte le salut et la délivrance à lui et aux autres… C’est pour ces raisons qu’il est d’usage, dans tout Israël, de donner abondamment à la tsedaka, d’accomplir de nombreuses bonnes actions et de s’investir dans les mitsvot, de Roch Hachana à Yom Kippour, plus encore que durant le reste de l’année.
Ici, Maïmonide nous invite à faire usage de notre imagination. Le rationaliste qu’il est n’affirme pas que le chofar, ou qu’une mitsva quelconque, sauvera littéralement le monde ; il nous propose plutôt de nous comporter comme si c’était le cas. Que ressentirions-nous si nous étions les seuls responsables de l’issue d’une guerre ? Ou si nous percevions, à chaque instant, la fragilité de la vie ? Le mot mitsva est ici compris dans son sens le plus large : non seulement les rites — allumer les bougies, mettre les téfilines — mais aussi agir avec justice, vivre avec compassion, et répondre à notre vocation d’êtres créés à l’image de Dieu. Là encore, il s’agit d’un exercice d’imagination, non d’une description du réel. Mais peut-être l’histoire de l’Alter Rebbe et de son chofar relève-t-elle aussi de cet imaginaire. Nos choix, nos actes comptent. Ce que nous faisons — ou ne faisons pas — a du poids. Et l’on peut tenir à cette conviction sans tomber dans le narcissisme ni dans la paranoïa. C’est à la fois terrifiant et rassurant : notre existence a du sens. Et maintenant que nous en sommes à nouveau conscients, il nous revient d’être à la hauteur de cette responsabilité à la fois redoutable et magnifique.
C’est peut-être pour cette raison que Roch Hachana est un jour de joie, bien qu’il soit aussi un jour de jugement. À Yom Kippour, nous accepterons pleinement le sérieux de cette idée du jugement : en jeûnant, en réfléchissant, en nous frappant la poitrine et en demandant pardon. Mais à Roch Hachana, c’est ce même jugement que nous célébrons. Quelle merveille d’être jugés ! Si nous ne comptions pas, si nos actes n’avaient aucune portée, il n’y aurait rien à dire, et nul besoin de distinguer entre bien et mal. Quelle merveille que chaque individu puisse y apporter sa part, et que notre avenir se façonne à travers les conséquences de nos actions et nos choix. Et parce que nous avons la confiance que nous serons jugés favorablement, que nous saurons nous améliorer et transformer notre conduite, nous célébrons déjà cette certitude. C’est avec cette confiance que nous partageons ce soir les pommes, le miel, les grenades et l’espérance.
Chana tova ou-metouka !


