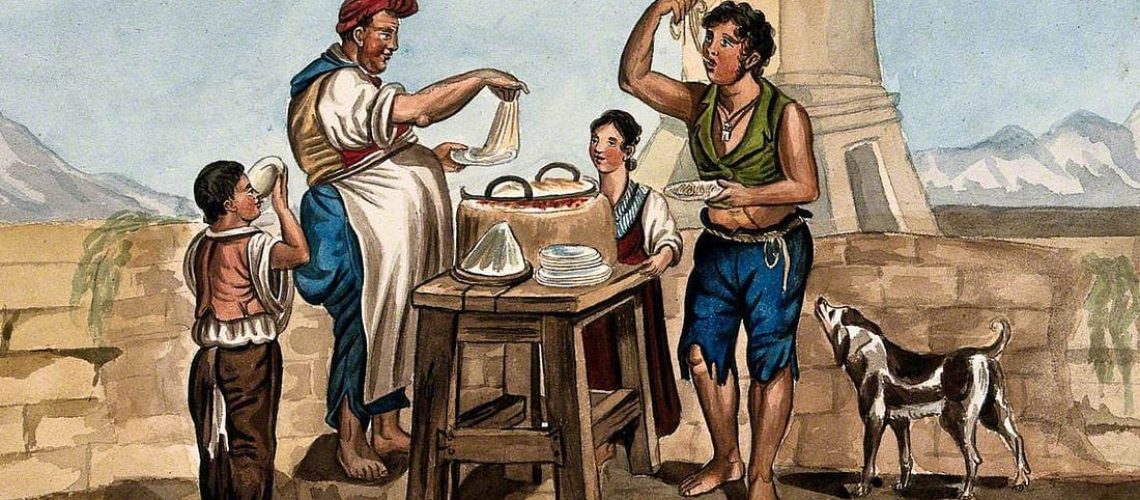Par le rabbin Josh Weiner
Le chabbat qui précède Pessah est connu sous le nom de chabbat Hagadol, et les juifs, qui ne peuvent rien accepter sans poser de questions, en soulèvent deux à ce sujet: pourquoi l’appelle-t-on Hagadol ? Et comment définir ce chabbat particulier qui précède Pessah ? Pour la deuxième question, certains soutiennent que dans une année comme celle-ci où Chabbat la semaine prochaine sera la veille de Pessah, alors c’est cette semaine qu’on célèbre Chabbat Hagadol — même si d’autres, bien sûr, ne sont pas d’accord. En ce qui concerne la première, certains relient le mot Gadol, “grand”, à un miracle qui s’est produit avant Pessah en Égypte, ou à un miracle futur avec le prophète Élie qui viendra “le jour de l’Éternel, grand et redoutable“. D’autres font le lien avec le long sermon du rabbin (qu’on appelle lui aussi ‘Gadol’ !) et qui profite de l’occasion pour rappeler aux gens certaines des lois compliquées de Pessah.
Cette semaine, j’ai lu un long poème intitulé Elohei Haroukhot Lekol Basar, qui fait 8 pages dans ma version, mais qui, dans certaines éditions avec des commentaires, fait plus de cent pages. Il a été écrit en France par R. Joseph Bonfils il y a environ mille ans et reprend toutes les lois de Pessah sous forme de vers rimés, classés par ordre alphabétique, et était chanté dans les synagogues françaises pour Chabbat Hagadol. Je ne pense pas que je serais très apprécié si je le réinstaurais à Adath Shalom !
Quoi qu’il en soit, bien que nous ne fassions pas la plupart des pratiques de Chabbat Hagadol cette semaine, et que je ne chanterai pas de sitôt des poèmes halakhiques de huit pages en araméen, je veux quand même commencer à parler de Pessah, car « parler de Pessah » est au cœur même de l’expérience de cette fête. Le nom de la fête est parfois compris comme Peh-Sah (פה שח), la bouche qui parle. La préparation physique a déjà commencé pour beaucoup d’entre vous, et sinon, commencera dans les prochains jours : nettoyer, balayer, déplacer la vaisselle, faire bouillir de l’eau, cuisiner. Mais il y a aussi beaucoup de discussions: demander parfois au rabbin comment faire ceci ou cela, inviter ou être invité à des repas, être confus et frustré, googler, demander des conseils à des amis ou à la famille, «C’est quoi ce truc que grand-mère faisait ? », « Est-ce qu’on mange du quinoa dans notre famille ? », « Est-ce qu’on doit vraiment nettoyer ça ? », et ainsi de suite. Je pense que le stress qui précède Pessah, sans aller jusqu’à l’extrême, est une partie importante de l’expérience qui renforce l’impact de la fête elle-même. Et les conversations que nous avons à l’avance sont également importantes.
La Torah dit (Proverbes 22) חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל-פִּי דַרְכּוֹ, instruis un enfant selon sa propre voie. J’ai commencé à préparer Pessah avec mes enfants il y a quelques semaines. Pour la petite, il s’agit juste de lui apprendre à chanter Ma Nichtana et à reconnaître la matsa. L’enfant de cinq ans est plus intéressé par l’histoire elle-même, et chaque soir, nous en abordons différents aspects. Il est très littéral et s’énerve quand je dis des choses comme « Nous étions esclaves en Égypte », parce qu’il trouve que ce n’est pas vrai. « Je n’y étais pas », dit-il. Et je réponds : Non, pas encore. Mais tu l’auras été. » Cette obligation de raconter l’histoire à la première personne crée une conscience par laquelle nous nous identifions à ce que nous disons, au point que cela devient vrai. Ce n’est pas seulement qu’un Juif doit se voir comme s’il avait personnellement quitté l’Égypte (Michna Pesahim 10:5), on pourrait presque dire que c’est l’inverse, que ceux qui peuvent raconter cette histoire en se voyant comme s’ils avaient personnellement quitté l’Égypte font partie du collectif juif.
Le commandement est de raconter l’Histoire aux enfants, aux amis, et même à soi-même (Maïmonide, Commandement 157). Mais quelle histoire exactement ? Cela change d’une personne à l’autre et d’une année à l’autre. Nous pouvons mettre l’accent sur différentes parties de l’histoire biblique, ou la fusionner avec notre histoire personnelle ou familiale. Pourtant, c’est le fait de la raconter qui est crucial, car si elle n’est pas racontée, elle cesse d’être une partie vivante de ce que nous sommes, et cesse d’affecter notre conscience.
L’auteur Paul Auster a dit : « Les histoires n’arrivent que pour ceux qui sont capables de les raconter ». C’est vrai pour les individus comme pour les communautés. Une partie de la force de cette communauté ne réside pas seulement dans les prières et les événements qui se déroulent ici à la synagogue, mais aussi dans l’histoire que nous racontons sur la façon dont Adath Shalom a été créée, sur les rêves qui l’ont accompagnée, sur les défis et les succès que nous avons rencontrés.
Le peuple juif est soudé par ses histoires, sans lesquelles nos rites ne seraient que des gestes étranges. D’habitude, je n’aime pas le terme français de « personnes de confession juive », il me semble un peu faible, mais il y a en fait quelque chose de sympa dans ce mot, le fait que nous ayons quelque chose à confesser, une histoire à raconter, a savoir : nous étions des esclaves, et maintenant nous sommes libres, au moins dans nos esprits, sinon toujours dans l’espace. Je pense aussi à la déclaration de Jean-Paul Sartre : « On n’écrit pas pour des esclaves ». Pouvoir raconter une histoire est en soi un acte de libération pour celui qui raconte comme pour celui qui écoute.
L’une des façons dont nous racontons l’histoire est par le biais de cérémonies. Nous accomplissons des actions et les expliquons ensuite. Moses Mendelssohn a souligné que cette Zeremonielle Zeichensprache, ce langage symbolique, était la façon juive de préserver les traditions écrites de la sécheresse, en leur insufflant de la vie à chaque fois que l’on raconte à nouveau les raisons des actions cérémonielles. Et encore une fois, ces histoires changent à chaque fois qu’elles sont racontées.
Un bel exemple que je viens d’apprendre est la pratique consistant à tirer des gouttes de vin des coupes pendant le seder, dix gouttes pour les dix plaies, puis trois autres et encore trois autres. Pourquoi faisons-nous cela ? Dans de nombreuses Haggadot, nous trouvons l’explication que cette diminution de notre coupe de vin pleine est pour démontrer notre joie diminuée, à cause de la tristesse pour les Égyptiens qui ont souffert et sont morts au cours de ce processus de libération. C’est une des explications donnée dans la haggada que nous utilisons ici à Paris. C’est également l’explication donnée dans des centaines de Haggadot modernes, où elle est parfois attribuée au sage médiéval Isaac Abarbanel (c’est le cas dans la Haggadah Artscroll), ou à R. David Abudraham (comme dans la Haggadah de Jonathan Sacks), et parfois sans source. Un article fascinant du rabbin Dr. Zvi Ron retrace l’évolution de cette interprétation, et montre comment elle est née à la fin du 19ème siècle en Allemagne, et a supplanté une explication antérieure qui parlait de la vengeance divine symbolisée par une épée à seize lames. Au cours du 20e siècle, la nouvelle explication a été reprise dans les haggadot en yiddish, en anglais et en hébreu, et a fini par devenir assez courante (bien que ce soit moins le cas en Israël). Ce qui m’intéresse dans cette recherche, ce n’est pas que l’explication moderne soit « fausse » ou non « authentique ». C’est que chaque génération raconte l’histoire qu’elle a besoin d’entendre. Aux 20e et 21e siècles, nous avons privilégié les récits qui incluaient une empathie universelle à celles de la vengeance.
Une partie des préparatifs de Pessah cette année, en plus des détails logistiques et halakhiques, doit être une question de narration. Que nous soyons en famille, en communauté ou seuls, ce ne sont pas seulement les mots de la haggada qui comptent, mais aussi les plaisanteries, les rires et les discussions profondes qui les accompagnent.
Bon courage pour tous les préparatifs, et Chabbat chalom !